Seconde Guerre Mondiale et Résistance

En 1939, encore la guerre ! C’est la mobilisation, tant parmi les hommes du village qu’au scolasticat. Le 15 juin 1940, après plusieurs bombardements aériens sur les ponts et la gare de Montereau, dans Villeneuve et à Pont-sur-Yonne, c’est l’invasion. Le château est occupé quelque temps par des unités allemandes qui y resteront jusqu’à la fin de juillet.
Le 22 juin c’est l’armistice. L’armée française est démobilisée, les hommes qui ont échappé aux combats rentrent à la maison, les autres, prisonniers ne rentreront qu’au compte-goutte ou à la Libération.
Les temps durs commencent pour tout le monde, restrictions, privations, humiliations sont le quotidien des Brossois. Si un grand nombre des habitants perçoivent dans le bon Maréchal un sauveur providentiel qui ferait tout pour soulager leur quotidien, les espoirs sont vite déçus. « L’occupation militaire, la politique de collaboration du gouvernement Laval, une connaissance plus précise du Nazisme, font que la mentalité de la maison évolue lentement… Le caractère foncièrement anti-chrétien du nazisme est mieux réalisé… L’apparition du STO va déclencher les premières manifestations d’opposition au régime de Vichy. » Père du Halgouët, OMI 1995.
Tôt, au scolasticat comme dans le village, des choix sont faits, même si personne ou presque n’a entendu le Général, on en parle. A Montereau toute proche, ville ouvrière, plutôt communiste, ville de garnison, la Manut’, le camp de prisonniers de guerre à Cimenfer, personne ne peut rester indifférent. Tout est propice à la germination de foyers de résistance, divers et variés suivant ses convictions politiques, son caractère et ses relations. Au scolasticat, dès l’automne 1941, les Courriers du « Témoignage Chrétien » circulent clandestinement à l’initiative du Père Piat. Des contacts existent entre des professeurs, la direction et des groupes de résistants à l’extérieur. L’assistance aux personnes est sans doute l’action prédominante. « Ne pas avoir à porter les armes » Dons du sang, soins à l’hôpital de Montereau, sauvetage des rescapés du train de Champigny, hébergement d’aviateurs tombés du ciel, de famille juive, de résistants isolés, traqués… « C’est au début de 1944 que l’engagement formel dans l’action résistante s’est précisé, au moins pour moi… » Père du Halgouët, OMI 1995.
Quelques jours après le débarquement, fin juin 1944, les messages : « Les lettres anonymes sont d’une grande bassesse ! » sur la radio des professeurs, annoncent l’arrivée de plusieurs tonnes d’armes. Vingt containers à chacun des deux parachutages, remplis de mitrailleuses « Sten », de grenades, de pistolets, de pains de plastic de munitions et parfois de chaussures, qu’une vingtaine d’hommes, qui ne se connaissaient pas forcément la veille, vont discrètement ranger dans le grand caveau du cimetière.
La suite, nous la connaissons tous. Un second parachutage qui ne se déroule pas bien, des erreurs d’appréciation, des maladresses ou des indiscrétions. Des aveux sous la torture, peut-être. Du pain bénit pour le sous-chef de la Sicherheitspolizei de la rue Delaunoy à Melun, Wilhelm Korf. Tortionnaire confirmé, plus de 40 assassinats à son actif dans le département, la déportation d’enfants juifs, il ne connaît que la brutalité. Et c’est ainsi qu’il entend s’y prendre pour savoir où sont cachées les armes ce 24 juillet 1944 aux aurores.
Après des heures de tortures à la baignoire ou au nerf de bœuf dans la salle du ciroir du scolasticat, Korf abat froidement le Père Gilbert en premier, puis le Frère Cuny. Suivront le Frère Périer, le Père Piat qui a été le plus torturé des cinq religieux et enfin le Frère Joachim Niot, le plus innocent de tous, devenu sourd et presque aveugle par les coups reçus. « …Vous avez vu ? Je vais continuer ! Six, sept, huit, neuf, dix, tant qu’il faudra ! On va vous grouper par dix !… ». Le massacre s’arrêtera par l’arrivée de quelques officiers de la Werhmacht. Les corps des victimes sont poussés du pied dans le trou béant du puits. Le scolasticat est dépouillé, les Oblats sont tous emmenés par camion à la caserne Damesne de Fontainebleau où ils seront interrogés sans torture durant quatre jours.
Le 28 juillet, les religieux arrivent au Frontstalag 122 de Royallieu de Compiègne sous l’étiquette : « coopérateurs passifs à la résistance ». Ils séjournèrent un mois dans cette antichambre des camps d’outre-Rhin avec pour compagnons d’infortunes tout un monde divers et bigarré, des politiques, des résistants, des juifs, des militaires alliés. L’évêque de Montauban, le maire de Toulouse, le Préfet du Tarn côtoient des manuels ou des professeurs, des gendarmes ou de jeunes du maquis. « …La semaine précédente, 1800 détenus partirent vers l’Allemagne, chaque semaine près de 200 nouveaux prisonniers arrivaient… Le 25 août nous quittons le camp pour Péronne à 70 km de Royallieu…. Le jeudi 31 août les grondements de l’artillerie alliée se font plus proches, nos gardiens prennent la fuite, le soir même la Croix-Rouge nous prend en charge, nous sommes libres…Pour moi, c’est en stop et en trois étapes que je regagne le domicile de mes parents à Landivisiau… » Père Jean Gueguen, OMI 1995.
Le 8 septembre, les Oblats quittent Péronne pour rejoindre leurs familles. Le Père Tassel et les Frères Convers reviennent au scolasticat, qu’ils retrouvent pillé, alors que depuis le départ de la Wehrmacht en pleine débâcle, personne n’a pu rentrer dans le parc. Les dépouilles des cinq oblats sont extraites du puits au milieu d’immondices jetées par l’occupant.
Le 16 octobre a lieu la cérémonie funèbre à laquelle participent de nombreuses sommités civiles et religieuses de Seine-et-Marne ainsi qu’une foule énorme venue rendre un dernier hommage aux héroïques victimes.
En 1946 est édifiée la Stèle dédiée à tous ceux qui ont donné leur vie pour les autres. « Nul ne peut avoir d’amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis ». Cinq croix de bois signalent l’emplacement où sont tombés les Pères Gilbert et Piat, les Frères Niot, Cuny et Perrier le 24 juillet 1944.
Après la guerre, les Oblats de Marie Immaculée s’installeront à l’abbaye de Saulignac près de Limoges. Les sœurs occuperont le château jusqu’en 1974, date de l’achat du domaine par le Crédit Lyonnais pour en faire un centre de vacances. Il est dit que le directeur du Crédit Lyonnais, M. Claude-Pierre Brossolette a acheté le château en souvenir du séjour qu’y fit son père M. Pierre Brossolette, résistant pendant le conflit.
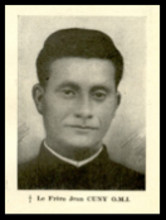
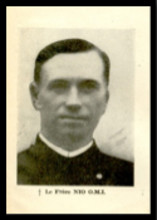
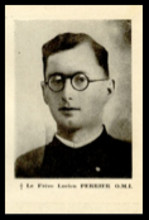
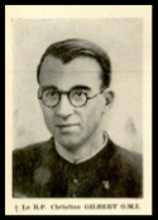

Partager :